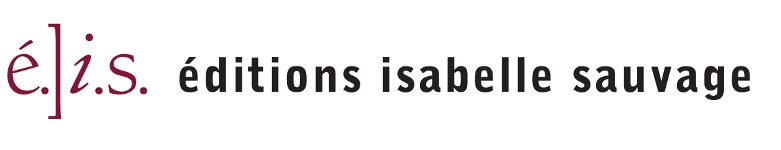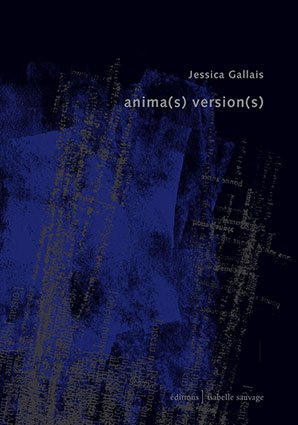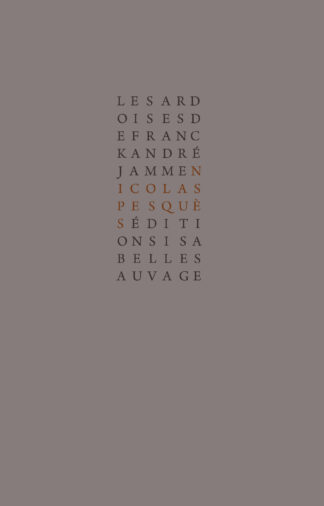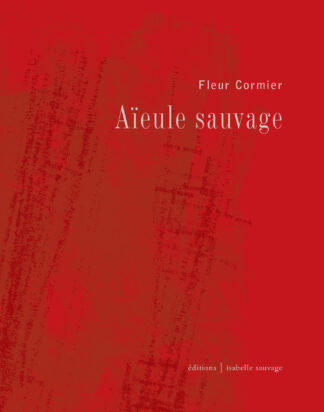Description
Les mots butent, glissent, se disloquent et s’emmêlent… voici sans doute un premier constat à la lecture d’Anima(s) version(s). Comme si la langue – du moins, une espèce de norme de la langue, une conscience de celle-ci – était travaillée avec violence, était violentée même. On comprend vite que cette destruction linguistique qui caractérise Anima(s) version(s) est le reflet de la lutte entre l’emprise extérieure (la société et ses habitudes bien-pensantes…) et un soi-même. Car avec ce livre, Jessica Gallais essaye de nous laisser entendre un être en construction de chair et de désir. Et ce sont là des lieux de non-sens, de hargnes érotiques, de charges sexuelles. Cela ne pouvait que produire cette dislocation des mots et des corps, unis par un même destin.
« Le plaisir est secondaire ; seul compte le désir », nous dit l’auteure. Mais l’accès à ce désir est-il possible ? Si cela était, le désir ne serait-il pas en lieu et place d’une idole, d’une puissance, ou d’une plénitude sans reste ? D’ailleurs si le texte est guidé par un énonciateur, un « je », il n’est pas dispensateur de sentiments ou d’affects. Ce « je » n’exprime rien, il surgit ; il exhibe un possible chemin vers… quelque chose d’inqualifiable. Et c’est aussitôt un éparpillement fébrile d’un sujet ballotté entre jouissance – qu’il faudrait entendre là comme un extrême – et impuissance dans le contrôle. Du coup, cette confrontation hésite entre angoisse et folie : n’est-ce pas là d’ailleurs l’un des enjeux du sexe ? Le désir comme un au-delà du plaisir, un sabbat où peau, sang, rites et accouplement se mêlent outrageusement ?
Notes de lecture
« Anima(s) version(s) est un livre lacéré ; le livre de la construction par lambeaux d’un corps habité par la sexualité, par la conscience de chacune de ses parties comme point sexuel sollicitant le réel et ouvrant sur des abîmes intérieurs de la conscience de soi. En effet, la construction d’un monstre s’élabore sous nos yeux, un monstre paradoxal, car l’entité qui nait par métamorphoses tout en se construisant est une entité aux formes rythmiques variables et variées à l’envi, et qui, dans l’ardeur d’être et la multiformité, recherche l’élégance de la beauté dans la “nuit sexuelle” qu’est la représentation de la réalité ; apparition lente et certaine sur la page d’un monstre beau ; qui est une âme plurielle née des cendres ténébreuses de la poète ; qui hurle, crie, crisse, voire glatit, esquisse puis dessine un sexe strident (comme un glatissement), est la maîtrise de sa propre dilacération et de la couture de l’être déchiqueté. Car la construction renaissante passe par une bénéfique destruction, proche de la tabula rasa. C’est un livre obscur, non pas dans l’écriture, qui est certes difficile, mais nullement hermétique, d’une obscurité ouverte. Un livre difficile parce que exigeant, précis, mais très mystérieusement attractif. […] Texte bestial et félin, cru et élégant, Anima(s) version(s) donne et invite à regarder, donc, la naissance de sa propre monstruosité, voluptueuse, hissée-issue du très fin fond de l’inconscient conscientisé, objectivé, peut-être “l’antre” de la poète, pour qui “Vient alors le temps d’érotiser le monde /// Les yeux ouverts /// Les Monstres concrets”. […] Un livre ambitieux, “Création sera le (maître) mot” (référence à la Genèse), un livre démultiplié, où le sens file, échappe, demande une part d’acceptation de l’illisibilité reflétée sur la page, qui est érotisée, au final, pour ce que les signes laissent deviner de béance. »
Jean-Pascal Dubost, Remue.net, 22 juin 2015« De partout dans ce texte anti-claudélien les mots deviennent le trait vagissant des chutes que le désir entraîne. […] Loin des guipures, des clichés, des clignotements d’enseignes la poétesse déplace le chant d’Éros. […]
[Les mots] affectent ici la visibilité du monde et son intelligibilité. Liant les deux sexes de manière vertigineuse, le phallus engloutit la vulve où il est lui-même englouti, tous deux conduisent de l’obscur à l’illimité en explorant les envers d’une réalité dont la face lumineuse ne contient pas tous les secrets. […]
La sexualité comme le langage reste le lieu de l’insécurité puisque ce qu’on y découvre permet aussi d’y discerner, de découvrir une peur dont il faut apprendre à reconnaître les arpents de lumière arrachés à l’obscur. L’auteure rappelle combien il serait nécessaire d’apprivoiser cette clarté qui couve dans les cendres toujours inachevées et encore incandescentes. »
Jean-Paul Gavard-Perret, « À bout de souffle », Sitaudis.fr, 30 septembre 2015« Il n’existe plus de dentelles dans l’écriture de Jessica Gallais. Elle est vêtue de nu, de mots brisés de corps et rappelle que l’être est né d’une perte. […] L’auteure parle à travers le désir — et qu’importe le plaisir. Seul le premier vit à découvert en complice du destin. L’écriture est son étendue qui ouvre le jour du monde à la nuit. Les eaux y tombent d’en bas. Ciel et terre sont dans la même lumière argentée désertant le désert, existant dans le hors, le trou d’attente et d’atteinte. De l’amant(e). Celle ou celui qui ne daigne pas voir le sablier dont le sable s’écoule ailleurs qu’en un présent “pur” (Proust). Dans une telle approche, les cauchemars se diluent peu à peu. Le désir est un chat qui sort sa retraite entre la faille du blanc, sur la brèche d’un texte rare. Et qu’importe si l’écriture ne sauve pas, ne sauve rien.
[…] Dans ce premier livre fracassant, les mots s’entrechoquent hors des sentiers battus et selon un étrange sacerdoce. Ce dernier tient au ventre (euphémisme) par la violence d’une destruction langagière. Elle laisse la place aux forces d’Éros qui unissent les corps au peu qu’ils sont (mais ce peu est un tout).
[…] C’est dans le champ même de la sexualité que la poétesse ne cesse de creuser, faisant de l’imaginaire amoureux et sexuel le lieu privilégié de l’exploration, au carrefour du monde extérieur et du monde profond : il n’y a pas seulement une face cachée (nocturne) du sexe mais cette face cachée est nécessaire à l’être. La poésie devient sa chambre d’enregistrement. »
Jean-Paul Gavard-Perret, « Anima vs Animus », lelitteraire.com, 30 septembre 2015« Les mots sautent et dérapent, taquinent la pupille. Ils tapent sur les nerfs du sens commun. Ils nous éclaboussent tel un foutre lexical. Oh ! Que le bon sens se voyait bien rester au chaud et reconnu par tous comme installé à demeure ! Et voici qu’on le découvre, copieusement éperdu d’être le dindon d’une farce lucide.
[…] ici c’est l’embryon de la langue qui est opéré. L’avant du vivant – le non encore langage – le fœtal – est mis à nu. Et c’est beau.
Pas de pagination. Cela aussi devient inutile. Une seule et même phrase répétée ? Déclinée ? Avide de rebondissements infinis ? Ou bien close sur elle-même ? Une phrase mercenaire ? Engagée dans les tournants abrupts de la décrépitude du moment ? Dans la guerre totale d’une direction à trouver ? Dans le meurtre de la facilité ?
[…]
Dans anima(s) version(s), les substances-mots et l’adjuvant-style forment presque une seule ph®ase, un tout compact et cohérent. Soutenu. Et pourtant, sa construction se disloque sous nos yeux à mesure qu’elle se raidit et se forme. Et se déforme. Et s’élève pour retomber en plusieurs décompositions qui se reconstituent aussitôt en d’innombrables et fraîches colorations, parfois quasiment animales. Leurs propos déversent en quantité des surgissements très élaborés. N’est-ce pas cela, inventer ?
Dans anima(s) version(s), on crie autrement. L’appellation se fait ajustement. Mise en place. On usine les impossibles. On sillonne on griffe le possible. Le poème rap/t/porte et tricote la plainte et le désir. Il n’est pas question de développer. Ce texte n’a pas le temps. Il a à peine celui de dire l’étendue de l’arrachement. J’absorbe ces combinaisons vagabondes pour mon plus grand plaisir. »
Marie Rousset, CCP – Cahier critique de poésie # 31 – 2, 2 décembre 2015