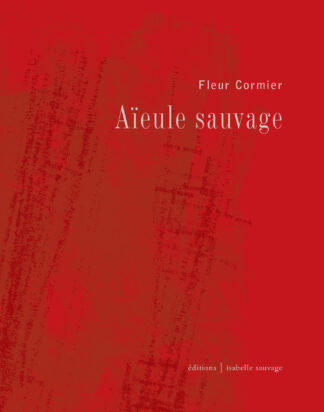Description
« Le mot “infractus”, ce mot des pauvres, des illettrés, des apeurés, je veux qu’il soit un mot puissant et vigoureux comme un chevalier, désignant le sentiment d’être brisé du dedans, d’être vaporeux et en lambeaux, sans base distincte. » Ce mot qui surgit à l’annonce de l’infarctus de son frère, Angela Lugrin s’en empare comme d’un « lieu-caverne » sur les parois duquel se profile l’ombre de leur lien de frère et sœur.
Si son frère se méfie des mots, Angela Lugrin sent au contraire qu’en ce moment de fracas elle doit de toute urgence écrire, faire battre le cœur de leur « amour indéfectible », pulser leur « langue commune » et réanimer… les vacances, les voyages, les fous rires, les parents, leur groupe punk, leur tendresse pour les bas-côtés et ceux qui y trouvent refuge. Ce recours à l’écriture est bercé par les livres témoins, par les mots de Racine, Duras, Quignard, Rousseau ou Bonnefoy qui, l’auteure le sait, portent et tiennent debout celui qui chancelle.
Angela Lugrin nous fait entendre ici une nouvelle fois la puissance de l’écriture et de la littérature qui savent, parfois, border l’innommable quand il fait effraction dans notre réalité quotidienne.
Notes de lecture
« Infarctus — mot latin et terme savant pour dire angine de poitrine. Infractus, néologisme d’inspiration latine d’un emploi populaire pour exprimer combien l’effraction du réel nous brise aussi intérieurement, et fait surgir des souvenirs enfouis dans la mémoire du corps, véritable bibliothèque intime d’images puzzle. Ici, c’est l’accident cardiaque de son frère qui vient bouleverser le cours d’une journée d’Angela Lugrin. Une artère bouchée dans le corps du frère médecin, et c’est tout le réel qui s’emballe : un passé fragmentaire réapparaît, faisant dévier la flèche temporelle du quotidien. Angela Lugrin narre une autre « journée particulière » que celle du drame d’Ettore Scola : elle est scandée par trente-et-une vignettes qui racontent “vingt-quatre heures de la vie d’une femme”, ou plutôt des vies d’une femme, tour à tour sœur, mère, fille de, belle-sœur, enseignante, adolescente voyageuse, baroudeuse, enfant turbulente, chanteuse, contemplatrice ou encore lectrice. La première vignette s’ouvre, à 6h30, sur l’annonce de l’infarctus du frère tant aimé. La dernière signale qu’un tour du cadran a bien été accompli, et que la vie tendue vers le futur peut se déployer : il est de nouveau 6h30, mais cette fois “C’est une belle journée qui commence” et un très beau livre qui s’achève.
La langue d’Angela Lugrin est magnifique, simple et posée, ténue et affirmée, comme sont magnifiques les personnages dont elle esquisse les traits, les gestes, les épreuves et les parcours. Le père, la mère, les grands-parents, les premiers amants, le compagnon, les élèves, les collègues, les enfants : autant d’êtres qui, malmenés ou broyés par la vie, sont touchés par une forme de grâce qui n’a rien de religieux ni de transcendant. Êtres exemplaires dont les maladresses, les failles et les blessures, les volontés plus ou moins blessées n’enferment pourtant jamais dans un statut de victime ou de bouc-émissaire. La souffrance et les échecs, la maladie mentale et la toxicomanie, la solitude et la marginalité, le travail et l’usure, la solitude et les choix radicaux déterminent, certes, mais n’enferment ni ne figent ces admirables vies minuscules. Tous ont un tel désir de liberté, et se caractérisent par un détermination à ce point affirmée qu’ils réussissent à faire de leur existence une expérience parfois effarante-effrayante, mais toujours unique : un diamant noir et artisanal, une création noire et nécessaire qui témoigne d’une dignité que rien ni personne ne peut le leur voler. »
Anne Malaprade, Sitaudis.fr, 24 juin 2019« 6h30, un appel téléphonique, le frère, un infarctus. […]
Des mots pour dire le temps, les espaces contrastés des sentiments et des relations, “Un vieux rêve douloureux refait surface”, des vocables aux beaux atours pour masquer les mauvaises odeurs, un infarctus qui fait face, “un mot bossu, décalé, maladroit”, l’enfance, la parole des démuni·es, la musique, le quintette à cordes de Schubert, “le violoncelle qui dit ce qui est bon et ce qui ne l’est pas”, le temps et ses heures, la fraternité explosive, le cri du dedans… […]
Les heures du jour et les inscriptions au passé-présent, Angela Lugrin, dans une certaine urgence, nous fait frissonner sur l’instant du “fracas”. Ce qui est et ce qui fût mais n’est jamais totalement effacé, “L’enfance est maintenant loin derrière nous, disons, qu’elle est entre nous”, l’improbable, Venise et une île pour les mort·es, l’“être en chemin”, des lieux de l’enfance, les amours informelles, les blessures qui rendent “invincible”, les larmes étranges qui montent parfois, la couleur des feuilles d’automne, les “gamin fée” et celleux n’osant pas devenir, les silences et certaines solitudes, Phèdre, “la familiarité triste que beaucoup de femmes entretiennent avec lui, je veux dire, le Soleil”…
Le bateau ivre, “la noirceur du fleuve fou sur lequel il tangue, sa beauté aussi”, la pêche et les études de médecine, des rimes et des nuits indiennes, le refus des clichés “virils”, une gifle, “C’est dans la fureur que ma mère tente de piéger sa douleur”, le grand-père et la graphie, le parfum de la ligne, les petits téléphones, la couleur du chagrin, Le Voyage au bout de la nuit, un livre important (mais comment taire cet écrivain infâme, cet homme abject, ce salopard dans le minuit du siècle), l’interrogation sur un “fichu déterminant”, San Michele, d’autres livres, une phrase pour “ceux qui n’ont pas peur des voyages”…
Vingt-quatre heures d’une femme. Un autre jour se lève, “C’est une belle journée qui commence”. »
Didier Epsztajn, « Le temps de vingt-quatre heures », Entre les lignes entre les mots, 5 juillet 2019« Constitué d’une trentaine d’étapes, de moments vécus comme les stations d’un chemin de réminiscence et de réflexion, In/Fractus est un hymne dont l’ambition est la révélation, l’annonce “urbi et orbi”, d’un amour entre sœur et frère pensé comme la pierre angulaire de l’équilibre psycho-affectif sur lequel l’auteure s’est construite depuis l’enfance. […]
Au fil des souvenirs, au gré des associations d’idées, dans un style d’apparence très simple mais profondément travaillé, poli, serti, Angela Lugrin écrit en son nom personnel. C’est un exemple abouti de ce qu’on nomme «“l’écriture de soi” ou “l’écriture de l’intime”. Elle “s’écrit” , selon le néologisme qu’elle impose. De manière impudique, mais non sans pudeur, elle transmue en “écrit” sa vie de tous les jours, ses relations avec sa famille, ses deux filles, ses parents, son mari et ses élèves. Elle en profite pour confesser ce qu’elle est, ce qu’elle pense, aime et déteste, ce qui constitue son système de valeurs, ses goûts, sa culture, ses sentiments et ses jugements. […]
De confidence en confession, la narratrice ne laisse rien de côté. Toute sa vie est questionnée, jaugée, évaluée. Ses écrivains favoris (entre autres, au fil des pages et des souvenirs, Rimbaud, Michel de Ghelderode, Molière, Calaferte, Racine, Duras, Rousseau, Bonnefoy, Bataille, Céline…), dont elle s’est nourrie, sont convoqués comme compagnons de route et témoins de ce qu’elle accepte ou repousse mais aussi de ce qu’elle ressent et comprend de la vie.
C’est un livre surprenant, attachant, qui frappe fort, questionne le lecteur, entrouvre des portes et débride la pensée. Mais c’est, avant tout, un hymne émouvant à l’amour fraternel. »
Jean-Pierre Logereau, « Hic et punk », En attendant Nadeau, 17 décembre 2019« Circulant dans le passé, l’entremêlant, au fil des heures, à son présent inquiet, ce sont également les êtres qui l’attirent qui surgissent. Tous ont des parcours assez cabossés mais ce sont eux, et pas les autres, qui lui transmettent un peu de leur colère et de leur énergie. Il y a là Stick , le punk des rues, “défoncé et rigolard”, qui assiste aux concerts du groupe de punk-rock qu’elle a formé avec son frère. Ou Bahiya, la jeune noire, toute en révolte, qui a donné du fil à retordre à l’enseignante qu’elle est. Ou encore, sur l’île, le chauffeur de l’estafette blanche aux bras piquetés de trous noirs à cause des seringues qui s’y sont enfoncées. D’autres se joignent à eux pour taper à la porte de ses souvenirs. Son père, sa mère, ses grands-parents, son mari, tous se donnent rendez-vous en ce jour où l’infarctus a frappé. […]
Pour réparer ce dedans qui se lézarde passagèrement, Angela Lugrin convoque, en plus de ses souvenirs, ses livres et ses auteurs de prédilection. Ils sont divers et nombreux. Elle parle d’eux avec enthousiasme et émotion et explique avec clarté, en une écriture souple et assurée, ce qui, dans leurs textes, à travers les personnages mis en scène, la touche en l’aidant à recoudre certaines plaies et à bien saisir, mieux comprendre, la complexité des êtres et de leurs vies fragiles. »
Jacques Josse, Remue.net, 9 décembre 2019