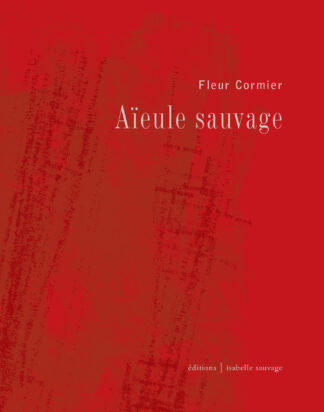Description
De la passion amoureuse, on pourrait attendre un chant ou un surcroît de lyrisme – un sujet réuni, enfin réalisé, qui clamerait ou déclamerait et qui s’élèverait vers un espoir transcendant. Pas de ça ici : Laurine Rousselet fait parler un corps, non commandé, presque sans subjectivité, quasiment détaché d’une conscience, dans la démesure de l’amour.
Les verbes à l’infinitif, nombreux, marquent son écriture. Sans marque ni de la personne, ni du temps, ni du nombre, ils nous conduisent hors d’une situation énonciative, hors d’une relation à la réalité ; transformés souvent en substantifs, ils expriment le vif d’un tourbillon émotionnel sans sentimentalisme. Finalement ces verbes donnent l’idée d’une déréliction où l’abandon des résistances s’affronte à la solitude des « dépassements » – l’insupportable propension à faire ou à penser les choses « jusqu’au bout » : « l’immersion suppose la nécessité de l’irréversible / le saut du septième étage pour voir ».
Un « corps de savoir », un « corps d’intuition », nous dit Laurine Rousselet, un corps qui « enfièvre l’écriture », où presque rien de l’être aimé n’est dit, si ce n’est les morsures qu’il laisse comme une « absence incalculable autour des reins ». Restent les humeurs corporelles pour entendre – comme seul visible de ce qui serait habituellement ignoré – l’effervescence de cette « guerre du dedans ». Ces humeurs qui viennent soulager « l’hallucination d’être / une source forcenée du cœur ».
« je se donne au besoin de dégagement » ou « je marche en perte » : deux vers parmi d’autres – peu nombreux – où on devine que ce sujet qui pourrait re-penser ou re-exister n’est plus que « la menace ». Contre celle-ci, il faut « tenir à la guerre / tenir à la langue / à tes mains sur moi toujours vivante » ; il faut batailler, pour gagner « l’amour au sommet du bassin », « l’infini par le sexe et l’amour ». Et le corps pourrait enfin régner, même souffrant et morcelé. Bien que « le sexe s’adapte à tout », le corps est « brûlant » et « enfiévré », aussi fait « de trous déchirants », « inondé d’abîme », « morceaux de ruines », car il n’est pas si facile d’avoir pour projet de « résister pour offrir au sexe son rouge »…
Notes de lecture
« Œuvre singulière née de l’urgence du cri, de l’insurrection intime du manque. […] Laurine Rousselet jette le trouble, risque l’ivresse des profondeurs. Ni narrative, ni descriptive, son écriture génère un chant elliptique, frémissant, battant de rythmes haletants, de pulsions langagières en rafales, qui sourdent des abysses de l’être. »
Michel Ménaché, Europe, n° 1024 – 1025, août-septembre 2014« Journal de l’attente et Nuit témoin, deux recueils que Laurine Rousselet a publiés dans une maison d’édition bretonne, constituent un fascinant diptyque. Les deux livres se ressemblent, sous leur belle couverture noire respective, noire comme l’attente trop longue, noire comme la nuit.
Il en va de même du contenu et de la forme : des deux côtés, il s’agit de poèmes courts, d’une quinzaine, environ, de vers libres, brefs et saccadés. Des obsessions textuelles et des thèmes récurrents se retrouvent également de part et d’autre et l’ensemble est recouvert de la même nappe d’obscurité féconde : un magma sous tension, qui mêle le point de vue de l’adulte et de l’enfant, du féminin et du hors-sexe, du sexuel et du spirituel pour former un long poème épique et nocturne, fort et sauvage, à la fois abstrait et presque impersonnel, organique, enfantesque, barbare, femelle, angoissant. L’écriture de Rousselet, dans ces deux livres, est corporelle, pulsionnelle, rythmée : le verbe, souvent à l’infinitif, est le mot totem de cette poésie de l’énergie et de la vitalité.
Il peut donc s’agir d’un seul flux recouvrant de façon arbitraire deux livres qui pourraient n’en faire qu’un seul. Mais la description inverse pourrait tout aussi bien convenir à Journal de l’attente comme à Nuit témoin. Car la poétique de Rousselet peut être ressentie comme particulièrement éclatée. C’est alors non pas l’ensemble des deux recueils qui servirait d’unité, ni chaque recueil pris isolément – ni même les poèmes, mais, tout simplement, le vers. Et celui-ci se limite parfois à un mot : “noué”, “entiers” ou “éclatant” dans Nuit témoin, “cavalée”, “percée”, “recrache” ou “feuer” dans Journal de l’attente.
Ainsi, la lecture de ces deux livres peut se faire d’abord de façon kaléidoscopique : dans les poèmes, certains vers, qui semblent briller davantage que les autres, s’isolent du magma comme “l’espace est une réalité mouillée”, “d’avance les soleils ne m’ont jamais manqué”, “ailleurs t’envoie un baiser bleu” dans Journal de l’attente et, dans Nuit témoin, “le quartier de lune cloue l’œil”, “la main prend feu de la vie”, “sur ma tête la nuit se jette de non-sommeil” ou “je m’inconnue”, qui marque le féminin de façon rare et troublante.
Mais il est aussi possible de considérer les poèmes comme des ensembles, en étant sensible à leur rythme interne : au début, l’énergie s’accumule, au moyen d’une succession d’infinitifs occupant des vers-phrases courts et autonomes, puis, comme dans un sonnet, une flèche finale apporte une forme d’apaisement, peut-être produit par la présence d’une phrase longue qui se déploie soudain sur plusieurs vers et qui résonne parfois comme une maxime classique. »
Laurent Demoulin, Culture, Université de Liège, juin 2017