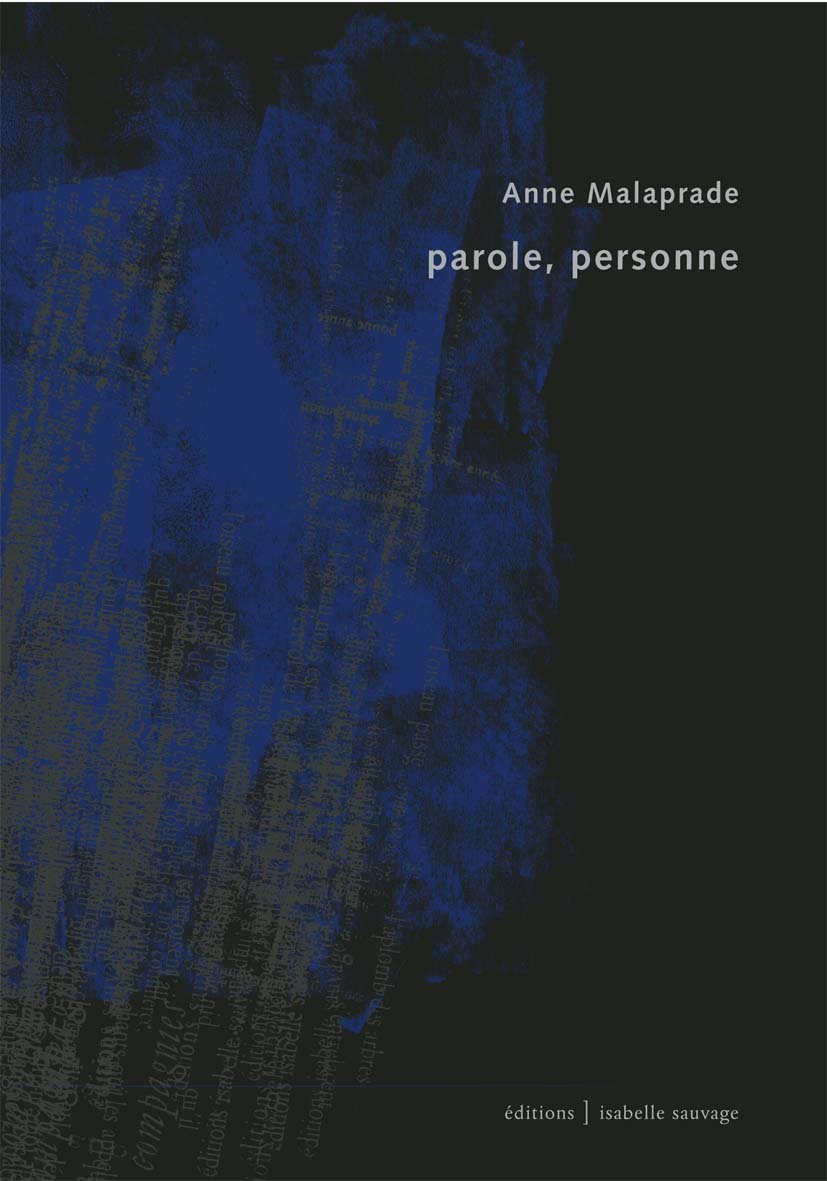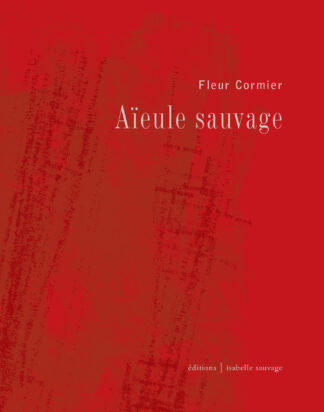Description
D’emblée Parole, personne, comme les précédents livres d’Anne Malaprade, se rapporte à la langue, aux mots, au(x) corps qui les portent : personne portant parole, Parole nom propre. « Parole travaille à rendre personne brûlant(e) personne touchante. » Si Anne Malaprade dit en prologue l’enjeu : « Montée vers la parole, l’ordre du pluriel ordonné, chute dans le corps noir de l’inconscient, ordre du singulier ordonnant », elle annonce aussi tout ce qui passe, dans ce livre, par l’image. 19 poèmes en prose précèdent 19 poèmes versifiés, aux titres semblables mais « retournés » de 19 à 1, et ce sont « 19 photos » d’un « album » où les deux versions se tiennent « comme les deux visibles d’une image ». La version prose s’intitule « Négatif, inspiration », la version poésie « Tirage, expiration ». Respirer : vivre. Passer du Livre abstrait, majuscule, au livre-recueil, développer des négatifs. Et de fait, encore, Anne Malaprade s’expose, prend un risque, on le saisit dès le premier texte : « Genèse : anne année zéro » (« moi dévore je qu’un tu déshabille »).
Mais si c’est d’elle qu’elle part, c’est de la multitude de ses corps (« corps noir de l’inconscient »), d’enfant, de fille, de mère, d’épouse, d’amante, qui donne une pluralité à la voix, et c’est bien un chœur de femmes qui se dessine ici alors. Que l’on entend résonner, faire écho entre prose et poèmes. Elle parle pour toutes les femmes, « Celles à l’imparfait du présent. Celles au futur incertain », « pour les jeanne les catherine les femmes cancérées les sans-homme les entêtées les volontaires les tuées tues », quand « les hommes disent qu’ils font qu’ils ont qu’ils sont ». Elle convoque les grandes tragiques, Rogodune et Suréna de Corneille, Antigone, Adèle Hugo, elle récite (crache ?) les textes de la Loi masculine (L’Écclésiastique), qui assujettissent la femme à l’homme — « l’ordre du pluriel ordonné ». Elle tente de s’autoriser un « singulier ordonnant », dans cette « amitié adultérine une filiation rouge féminine ultra-sanguine » (« les lèvres et les bas rouges, ces dessus-dessous »), avec « toutes les filles enveloppées dans le manteau du père ».
« La brûlure monte par l’intérieur, lèche et creuse l’intime. » L’écriture, nerveuse, tendue, dit comme ce refus se fait dans la douleur, dans l’incompréhension, dans le désordre et le corps-à-corps (« J’hésite en elle. Elle plonge en moi »). Dit comme la nuit est là toujours, « cérémonie des ombres », parce que « Demain un corps doit / demain le rôle demain le masque ».
Et finalement, ne faut-il pas retourner le titre ? Il n’y a personne pour entendre la parole. Parole !, il n’y a personne… Parce que toute une partie du livre donne aussi ce renversement (mais tous ces mouvements sont parallèles) : l’effet du livre réel, édité (et le silence, ou la gêne, qui l’entoure), des mots publiés, sur le corps de l’auteure. « Une fois le corps publié […] on se-vous-lui-elle demande pardon d’avoir confondu le dehors et le dedans. On rétablit des frontières, on retourne à la ponctuation, […] on marche nu-pieds corps plein pâte et plâtre de nouveau détesté. »
Reste un livre d’une grande force, « Un geste vulnérable par lequel le présent plus jamais ne liera notre passé. Je coupe les fils, ses fils, ses filles, je raye les enfants, efface les ancêtres ». Servi par une écriture magnifique et d’autant plus remarquable qu’elle réussit le contrepoint prose et poème avec une grande justesse, sans que l’une éclipse l’autre.
Notes de lecture
« Beaux et forts moments, ma chère Anne, passés avec toi, ton livre, cette “parole, personne”, à entendre aussi bien sans virgule et dans tous les renversements ! Quelle énergie, dirait Antoine Emaz ! Quelle force singulière, indomptable mais transmise, transperçante, extractrice. Les phrases vont loin, très loin, fouillent ta mémoire mais aussi la mémoire collective. On suit avec étonnement cette envolée finalement très lyrique au cœur du sans-fond, si j’ose nommer ainsi ce qui reste quand on a coupé tous les fils ; cet hyper-lyrisme a pu, parfois, me rappeler celui d’Anne-Marie Albiach. Les raisons de cette “inconduite” sont multiples, exposées et s’adressent très discrètement dans l’enchaînement des mots ; on en a un premier aperçu dans les titres de tes 19 “séries” : genèse des femmes, les enfants herbes sages ou l’accident de lecture… Pourtant tout reste ouvert, c’est cela aussi le vrai miracle du livre, comme en suspens, comme s’il fallait aussi apprendre à s’accorder à l’impulsion du sens et à son implosion ; toute la part musicale, en somme. Et puis, comment ne pas suivre d’abord la saga familiale (mais pas une histoire de famille, et c’est très bien ainsi), l’histoire de toutes les femmes en une, … en l’autre : les je sont traqués, troqués, modelés à satiété, mais jamais saturés. Tout cela “under control”, malgré les déchirements !
Alors, bien sûr, chacun aura probablement sa préférence… Tu l’imagines, je me suis senti de plain-pied avec “Tirage, expiration”, cette deuxième moitié du livre – la “version poésie” dis-tu – admirable de concision, de discrétion, de concrétion, d’insolitude ; et me suis senti un peu plus “excentré” avec “Négatif, inspiration”… Pourquoi ? Probablement parce que j’ai eu parfois du mal à reprendre ma respiration tant la tension y est forte, l’air (parfois) irrespirable. Mais ça ne concerne ici que le lecteur tristement défaillant que je suis… Et probablement, ma façon bien trop désordonnée de rentrer dans l’enivrant récit qui (dé)compose toute la première partie du livre. Comment se confronter à de tels enchaînements : “Les filles fatales. Éclat, meurtre comprimé en sous-sol, dans la cuisine les couteaux sont bien plus nombreux que les convives.”
Je suis avec admiration ton parcours de livre en livre ; l’œuvre se construit. C’est très beau, très fort, habité et parlant au-delà de toutes les grilles ou griffes de parole… »
Didier Cahen, « Lettre ouverte à Anne Malaprade », Sitaudis.fr, 29 mai 2018« […] La poésie de ce livre est multiple : la saisie singulière du réel par une sensibilité blessée y participe, entremêlant les notations prosaïques, les références littéraires et filmiques, les images nées de la violence des relations, des sentiments, du passé comme du présent douloureux. Mais il y a aussi un travail d’écriture très différent dans les deux parties : dans la première, la prose penche vers une langue marquée par l’emportement, les reprises, le flux, et un souci constant pour le son, le rythme et la vitesse, les échos, les glissements… Le vers libre, dans la seconde partie, serait plutôt une écriture de la fragmentation, de l’élan et de l’arrêt brusque avec rejets, détachements, blancs… produisant une musique heurtée et tout un jeu complexe, inventif, de découpe, juxtaposition, montage. Le sens est émietté en petites unités qui se recomposent à la façon d’un puzzle toujours en train de se faire ou de se défaire. On demeure bien dans le monde de l’auteure, mais dans une sorte de proximité et de distance où la parole à la fois dit tout et reste fermée. Si “la beauté relève du secret” (p. 41), lorsque “je n’a plus son code secret” (p. 84), le poème doit permettre encore de sauver la beauté ; tel est peut-être le pari réussi de ce livre. Dans un court texte liminaire, l’auteure annonce crânement, “vous allez voir ce que vous allez voir” (p. 10) ; plutôt que d’entendre ici une promesse d’extraordinaire et d’épate, je crois qu’il vaut mieux voir un sourire et entendre la formule au ras de ce qu’elle dit, une tautologie, vous ne verrez que ce que vous verrez, ou vous verrez ce que je vous laisse voir ou ce que je peux vous donner à voir. Ainsi le poème dit et préserve, à la fois, le “secret”. Il y a autant de dévoilement que de retenue dans ce livre. »
Antoine Emaz, Poezibao, 27 juin 2018« […] Une des forces de ce livre est de naviguer entre le particulier et le général. Dans Notre corps qui êtes en mots l’auteure semblait garder une distance alors que ce livre paraît plus personnel, jusque dans l’évocation de “ma fille édith” (p. 81). L’une des lectures possibles du titre* même pourrait en être le principe : qui parle ? L’énonciation glisse du elle au je (“Elle, prise au je”, p. 46 ; “Elle sort progressivement du ‘je’ pour longer sa honte de toute sa langue sa vie entière filet rouge” p. 59) en annulant la séparation des deux : dans le corps de femme qui écrit, remontent tous ces corps prisonniers sinon interdits : “Deux ou trois corps que je sais d’elle.” (ib.). Mais cela peut s’entendre aussi comme l’impossibilité d’accéder à une énonciation uniforme quand le corps est fragmenté ; en quelque sorte, tout ici devient corps : la tête, la pensée, la mémoire, soi en un mot, et donc tout serait à reconstruire. Même “les morts ne veulent plus de nous – les tombes nous reconduisent” (p. 58). Mais avant de reconstruire, il faut bien mettre à nu, faire un état des lieux, comme le fait ce livre. […] »
* L’étymologie du mot personne désigne le masque de l’acteur, soit une façade, mais on se rappellera aussi la façon dont Ulysse en use avec le cyclope Polyphème.
Ludovic Degroote, Poezibao, 27 juin 2018« Parole, personne
Je suis frappée par la puissance de ce texte d’Anne Malaprade, puissance est un mot que j’attribue rarement à un texte mais qui est pour moi essentiel. C’est une prose dense, mais aussi fluide, elle impacte à chaque instant sans étouffer, elle donne le sentiment de ne pas être épuisée en une seule lecture mais de demander plusieurs “passages” comme on le dit en gravure. »
« Anne Malaprade
[…] On est en présence d’une sorte non pas de polyphonie mais de concaténation de voix non harmonieuses, hurlantes, grinçantes, étouffées parfois, tendres aussi fugitivement, moqueuses, toutes ces voix auxquelles on a été soumis, soumise surtout : injonctions, commentaires, remarques, ordres, appréciations, moqueries, paroles tueuses. Immense tissage de voix emmêlées, féminines pour la plupart, discours intérieurs, malédictions ancestrales, voire mythiques, et révoltes étouffées. Un sombre univers de résonances. »
Florence Trocmé, Le flotoir, 26 juin 2018
[et ne pas hésiter à aller au bout de ces pages du Flotoir, un autre paragraphe reprend des digressions autour de la danse, de Fourcade et d’Anne Malaprade… trop long pour être repris ici]« Anne Malaprade avance sur une ligne de crête, comme Teresa, son personnage, elle est une fille-tornade capable de chanter, de combiner le son au sens, capable aussi de mots violents – “lâche-moi, casse-toi” –, de se traiter de chienne. Il s’agit d’inventer une langue, c’est certain, une femme, c’est probable, et, s’enfonçant dans la nuit noire, de sortir du tracé de la version préexistante. Projet qu’elle poursuit avec son dernier livre, Parole, personne. »
Marie Étienne, à propos de L’Hypothèse Tanger, CipM, 2017, dans « Portraits de poètes », En attendant Nadeau, n° 60, 18 juillet 2018« Dense, fluide, Parole, personne, le sixième livre d’Anne Malaprade […] confirme qu’on tient en elle la poète et critique la plus douée de sa génération… »
Didier Cahen, Le Monde, 21 septembre 2018« Parole, personne est un petit livre magnifique et complexe. Construit sur une spécularité, il s’annonce comme un miroir tendu au lecteur et à son auteure : divisé en deux, il porte d’un côté la prose, le tirage et l’inspiration, et de l’autre, les vers libres, le négatif et l’expiration. De chaque côté, rigoureusement les mêmes titres, dix-neuf fois repris, en symétrie parfaite […].
Un miroir donc, qui propose des photos, et même des galeries de portraits de la famille et de l’humanité toute entière compressée dans cette foule rappelée au réel par le biais de l’écrit. Ces clichés rappellent et rendent hommage. “Deux ou trois corps que je sais d’elle”. Ils révèlent aussi les souffrances de générations de femmes, quasiment réduites à un corps, malade de violence et de veulerie, de délétère chimie absorbée et d’impuissances, obscurément reproduites sur les générations d’après. […]
Le livre fait corps avec l’intime, avec le corps, avec l’organique dont il reprend les déchirures, les blessures, les fragmentations et les zones d’ombre jusqu’au point de non-retour. »
Marie Cazenave, L’Intranquille, n° 16, mars-septembre 2019