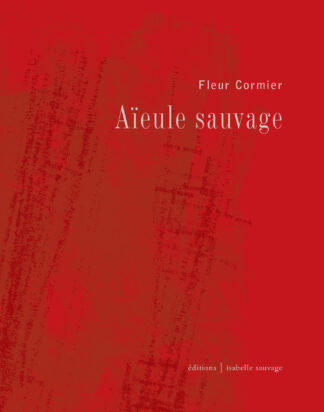Description
Chaque livre de Christiane Veschambre porte en lui l’interrogation de l’écriture, ses manifestations, sa nécessité, son surgissement : d’où écrit-on ? dit la femme dit l’enfant creuse cette question une nouvelle fois, sous la forme inattendue d’un dialogue, voire d’une pièce de théâtre intérieur.
Une enfant apparaît au seuil d’une pièce où se tient une femme. Elle reste à la lisière de cet « autre monde », une « mer de tapis ». « D’où viens-tu » est la première phrase du texte, question que la femme pose à l’enfant. Un échange commence entre elles, oscillant entre le monologue intérieur et le dialogue ; la femme tutoie l’enfant et l’enfant s’en tient au pronom « elle » ou à « la dame », utilisant quelquefois le vouvoiement (et une fois le tutoiement mais le quittant aussitôt). Les voix alternent, chaque fois ponctuées de « dit la femme », « dit l’enfant ». Toujours, elles se répondent.
La femme parle parfois au futur : elle sait (« le gilet que tu perdras »), mais pas l’enfant (« et, je ne le sais pas, cette ignorance sera ma singularité »). Si la femme reconnaît l’enfant (« Tu es mon intime autant que mon étrangère »), a peur de l’effrayer, si l’enfant hésite à franchir le seuil de l’inconnu(e), s’en protège en même temps qu’il l’attire, bientôt leurs deux « mondes », « celui où l’on écrit les livres » et « la vie de hlm » se révèlent moins opposés, davantage poreux. C’est que le temps n’est pas linéaire ici : présent, passé, futur se croisent, se superposent.
Plus on avance et plus on assiste à la superposition (avant que les voix n’en fassent plus qu’une) en même temps qu’à un retournement : davantage que l’enfant qui doit arpenter l’étranger qui s’ouvre en elle, c’est la femme qui se sent acculée sur le seuil : « Tu es au bord. Moi aussi. Pas le même. » Et c’est bien de cela qu’il s’agit pour la femme, « revenir là où j’étais quand tu étais là aussi », « pour que trouve voix l’incommunicable » « par l’usage humble et tendu de ma langue commune ».
Sans doute Christiane Veschambre ne se sera-t-elle encore jamais autant livrée, bien que tout en pudeur, sur les origines intimes de son écriture, se retournant sur ses chemins, ré-arpentant ses traverses. Et l’on ne peut que reprendre ce très beau parallèle qu’elle fait avec La Jetée de Chris Marker : la femme retourne au bout de la jetée, maintenant de toutes ses forces ce surgissement en elle, cette émotion jamais éteinte « poing serré, resserré autour de la langue qui file alors comme la lanière du fouet lorsqu’elle est libérée ».
dit la femme dit l’enfant a été sélectionné pour le prix des Découvreurs 2020 – 2021.
Voir le Cahier d’extraits proposé par Les Découvreurs.
Notes de lecture
« Je l’ai déjà fait par le passé1 mais c’est toujours une épreuve de rendre compte d’un récit de Christiane Veschambre parce qu’il y a ce que j’appellerai “une bulle de lecture” qui nous entoure et qu’il est difficile de retranscrire quand on en sort. La bulle éclate, le livre est terminé il faut le ranger et le cours de la journée reprend ses droits. Différemment peut-être parce que le temps du livre, de sa lecture d’une traite, la vie réelle et matérielle semble avoir disparu, s’être évaporée pour nous laisser seuls tout à notre écoute de la voix d’une auteure qui, je me le demande, n’écrit pas ce qu’elle veut mais ce qu’elle doit.
Cette question, je me la pose davantage encore avec son dernier livre, dit la femme dit l’enfant, où s’installe un échange inattendu entre ces deux “elles” qui alternent entre le dialogue et le monologue intérieur. Des questions parce que d’abord lointaines l’une de l’autre, “Tu me regardes comme l’étrangère que je suis et nul ne peut me revenir plus que toi”, la femme et l’enfant se jaugent sans se brusquer, au passé, au présent, au futur avant que leur deux mondes finissent par se rejoindre ; leur voix à l’unisson l’une de l’autre mais aussi toujours séparées : “Tu es au bord. Moi aussi. Pas le même.” Deux bords rejoints par le verbe “dire” qui rythme le récit non sans rappeler Les vagues de Virginia Woolf où là aussi “dit Rhoda”, “dit Bernard”, “dit Neville”, “dit Jinny”, etc.
La comparaison entre les deux pourrait s’arrêter là mais on retrouve dans le récit de Christiane Veschambre une angoisse qu’elle n’avait encore jamais livrée auparavant et dont elle semble se défaire par les mots […].
Un livre tout en profondeur dans lequel l’auteure, “provisoirement adjacente à l’autre monde”, n’hésite pas à faire tanguer le passé et où chaque mot semble se retourner sur les années tracées. Le temps s’est enfui mais le livre est parvenu à l’immobiliser. Un pied sur le seuil, l’autre sur le bord, la femme au bout de la jetée semble plus que jamais libérée de ce qui l’effrayait : “je me tiens sur le seuil, un drôle de seuil, au bord d’un monde qui n’est plus l’autre monde, celui que j’appelais l’autre monde, mais celui-là je ne l’appelle pas, il ne me regarde pas, il a la face noire de l’incompréhensible, il ne veut que m’effrayer, mais il ne peut pas me faire peur, il ne me connaît même pas.” »
Benoit Colboc, « Du seuil au bord, un monde », Lundioumardi, 10 mars 2020
1. Voir : Lundioumardi du 13 mars 2018.« […] son livre met en place un dispositif formel permettant l’entrelacement, l’écho, le dialogue contrapuntique entre deux voix. Se superposent de manière organisée et se répondent de manière croisée deux lignes mélodiques distinctes n’ayant besoin ni de visages, ni d’identités, ni de tirets et encore moins de guillemets. Théâtre d’ombre : deux masques prennent la parole et s’adressent aux femmes et aux enfants que nous sommes tous, hommes, pères, fils compris, par intermittence.
[…] Chaque paragraphe fait entendre l’une des voix, dont le son, mat, est celui de l’écrit. Cependant cette découpe autorise des flottements et des glissements : la femme a été un enfant, l’enfant sera un jour une femme. Ce sont les consciences, ici, qui parlent, et elles sont portées, soufflées par l’inconscient. Consciences temporelles incarnées en deux âges différents, consciences qui se confondent parfois, tant l’inconscient, lui, n’a pas d’âge, et ne connaît pas le temps. D’ailleurs derrière ces deux âges se profilent d’autres étapes cruciales de la vie : celui de l’adolescence marqué par la venue des règles, celui de la vieillesse dont la silhouette, ici, est associée à l’incommunicable.[…]
Écrire, cependant, touche celui qui est ou se croit protégé. Toucher n’est pas “caresser” mais “concasser” : il s’agit de réduire une matière solide — l’héritage, massif, brutal, imposant — en petits fragments, soit, ici, cette série de deux fois douze textes qui existent, se laissent saisir, se coulent dans le dire. Fragiles, ils ont néanmoins l’audace de vouloir connaître les vivants, tout en acceptant que les morts, eux, conservent leur part de mystère.
Le livre s’ouvre sur le motif du terrier et se ferme sur celui de la grotte. Nous sommes des animaux certes, mais nous avons aussi la possibilité de sortir, de nous désenchaîner, de nous retourner. Platon, déjà, le racontait dans le mythe de la caverne. Il n’y a pas d’arrière-monde, pas de monde derrière ce monde-ci. Et cependant le terrier comme la grotte, abris confinés, laissent s’échapper des voix, des silhouettes, des corps et autant de perspectives narratives. Ce sont la femme et l’enfant qui le disent… »
Anne Malaprade, Poezibao, 27 mars 2020« Christiane Veschambre nous entraîne dans ce petit miracle-là, propre à son écriture, superposant le temps, le présent, le passé, le futur. Accueillant ce qui surgit, venu du fond du corps et de la parole, par la présence autant que par l’absence, par les émotions soufflées par le vent. […]
S’agit-il de retirer les murs qui existent entre les mondes ? Il se pourrait, car dans la deuxième partie du livre, l’enfant tutoie la femme. Puis les deux voix se superposent, prennent possession du temps et de l’espace.
“Nous sommes à l’intérieur du temps comme à l’intérieur de l’espace, qui n’a pas d’intérieur puisqu’il n’a pas d’extérieur.”
Ainsi une réponse à ce que pourrait être l’acte d’écrire, ce qui “atteste du passage de vie secrète en nous, atteste de ce qui n’existe que pour nous”. La femme et l’enfant ne sont qu’une seule langue commune. C’est cela écrire. Ca commence et ça continue, tant que “je suis en vie”. »
Cécile Guivarch, « Hep ! Lectures fraîches », Terre à ciel, avril 2020« Rares finalement sont les livres qui bouleversent. Non de cette facile émotion qui nous traverse au spectacle ou à l’évocation de ces situations où la vie dont nous nous croyons proches se voit ravager, violenter, mutiler, contrarier, par l’ordre naturel ou politique des choses. Mais de ce saisissement intime, de cette consolante tristesse, que produit la lecture d’un texte dont le filet lancé de phrases parvient à ramener à la conscience quelque chose en nous de l’épaisseur frémissante et incommunicable de la vie.
Ceux de Christiane Veschambre sont de ceux-là. Dans ce tout dernier ouvrage que publient les belles éditions isabelle sauvage, deux paroles s’échangent de part et d’autre d’une frontière en principe impossible à traverser, qui est de temps. Qui est aussi celle qui sépare les vivants et les morts. L’enfant qu’elle a été se tient devant une femme parvenue au crépuscule de sa vie au seuil de la maison qu’elle habite, trouant par sa présence fantasmée l’univers d’habitude et la consistance plus ou moins assurée de sa vie.
[…] Si bien entendu, dans sa recherche du moi perdu, le dispositif imaginé par Christiane Veschambre lui offre toute latitude pour revenir, comme elle a l’habitude de le faire, sur ses origines familiales, de raviver bien des atmosphères, comme bien des détails précis de son existence passée, comme de faire le point aussi sur ce qu’elle est devenue, notamment par ce que lui auront apporté sa curiosité artistique, sa pratique personnelle de l’écriture, sans oublier la présence à ses côtés d’un compagnon aimé, les choses comme toujours chez Christiane Veschambre vont plus loin. Plus loin que les pittoresques évocations sur lesquelles elle s’appuie, plus loin que les considérations sociales même majeures qui ne sont jamais absentes de ses réflexions, plus loin au fond que le simple contenu de matière signifiante, que chacun trouvera à l’envie, dans ses livres.
Alors pour reprendre l’intitulé d’un de ses précédents livres de poèmes, quelque chose approche, qui relève cette fois de la commune, vacillante et terriblement émouvante présence d’un temps qui ne tiendrait plus seulement à celui des montres et des horloges. Mais à cette disposition subjective qui fait ici le noyau secret d’une écriture qui rassemble. Et comme dans la chaleur fragile peut-être et hasardeuse d’un vieux poêle au matin, ramène autour d’elle son petit peuple de fantômes, d’êtres chers, d’aspirations, de curiosités et d’appétits illimités de vivre. Reprenant corps ou plutôt mouvement, battements silencieux de signes, sur les parois de ce livre-grotte, dont son auteur aura fini par faire le seul, unique, monde. Qui leur soit quelque peu commun. »
Georges Guillain, « Dit la femme dit l’enfant. Christiane Veschambre à la rencontre de son moi perdu. », Les Découvreurs, 3 avril 2020« Soulever le “vent de l’émotion” qui porte à écrire : telle est, de livre en livre, la recherche inlassable de Christiane Veschambre. Telle est aussi celle de dit la femme dit l’enfant – sans majuscule et sans point final – qui se situe explicitement dans la continuité d’Écrire un caractère (2018) dont une phrase sert ici d’épigraphe et d’introduction :
Écrire revient par la brèche – une trouée dans l’enceinte fortifiée. Par exemple, tout à coup une enfant se tient dans la pièce où on était assis… Certes on est seul à la voir mais elle est si réelle, d’une réalité augmentée, on n’en parle pas, on est requis de lui parler, de l’écouter, c’est-à-dire d’écrire.
[…] Des évocations fragmentaires du passé de la femme ‒ le présent de l’enfant ‒ apparaissent, sans chronologie particulière, au gré des vents : des vêtements de laine, un poêle, les cabinets à la turque sur le palier d’un immeuble modeste, les mains d’une mère dite “sans profession” qui fait le ménage chez les autres, et surtout la grand-mère en qui le lecteur reconnaît celle qui “n’avait pas appris à reconnaître sur le papier les signes du langage” de Basse langue (2016). Pour l’enfant, cette grand-mère est “l’incommunicable” qui dépose en elle quelque chose qu’elle ignore, “et, je ne le sais pas, cette ignorance sera ma singularité.” […]
L’opposition du grumeleux et du lisse qui animait Basse langue devient à la fin de ce parcours opposition du rythme et de l’immobilité. Jamais l’écriture de Christiane Veschambre n’a épousé autant son propos que dans cette plongée intérieure où se brassent passé, présent et futur, chaque réplique de cet étrange dialogue ouvrant un “passage de vie secrète en nous” dans le geste même d’écrire. »
Nathalie de Courson, Poezibao, 6 avril 2020« La femme parle au présent, quelque fois au futur, les dialogues se mêlent aux monologues intérieurs, les temps s’entrelacent et s’imbriquent, les chemins de l’écriture s’exposent et se dissimulent. Les miroirs des mots résonnent dans l’ombre des pensées furtives…
Une langue peut-elle être confinée à un seul usage ? La nuit permet-elle de mieux deviner et apercevoir ? “Dois-je me tenir toujours au bord, dit la femme, pour que tu te tiennes au seuil ?”, que faire des questions sans adresse ?
Le connu et l’inconnu, l’absence de vocables pour cet autre monde, les mots qui ne sortent pas de la bouche mais qui se trouvent peut-être sur les chemins de l’errance, les ouvertures, “les choses humides enfermées moisissent”, le froid de l’autre espace, l’histoire remémorée, la guerre d’Algérie, l’odeur fade des corps familiaux, les fantômes, les interrogations sur le voir, Une femme sous influence de John Cassavetes, les écrans noirs de nos nuits blanches comme le chantait Claude Nougaro, les paroles lancées à haut risque, “la blatte qu’est devenu Gregor Samsa”, les mondes de la réalité imaginaire… […]
Je trace les ponts permanents entre la littérature et le cinéma, les bords et les seuils. Je déroule les images en me saisissant des allusions de Christiane Veschambre. Je marche moi aussi sur cette jetée de Chris Marker. Je m’empare des images pour animer d’autres phrases. Je voyage immobile et marche dans ces paysages à peine animés. J’apprécie “la burlesque matérialité” des corps et des voix, le corps sexué et sexuant, ce qui peut-être vu “sur le seuil”, peut-être un instant puis-je être cette femme et/ou cette enfant. Je perçois “l’usage humble et tendu” de la langue commune… »
Didier Epsztajn, Entre les lignes entre les mots, 10 avril 2020« “Dans tout ce que j’écris, presque tout, il y a ma grand-mère, et sa fille, c’est pour ça que j’écris. Pour ça : faire parler ça, pour donner de la langue à ça, qui n’a pas de nom, qui est comme le foyer très enfoui de combustion très lente, avec éruptions imprévisibles, qui tient au chaud ce que je dois écrire.”
Impossible, en lisant ces lignes, de ne pas songer à Nathalie Sarraute, à la toute première phrase d’Enfance : “Alors, tu vas vraiment faire ça ?”. Je risque ce rapprochement même si l’analogie entre les deux auteures ne tient pas au-delà que dans ce ça.
L’écriture de Christiane Veschambre puise toute sa source dans ses origines familiales. Dans “l’impasse noire” d’un village où une enfant sans père vient au monde. “Une enfant d’impasse ”, sa propre mère. C’est ce ça qui ne se nomme pas qu’il faut faire advenir, qu’il faut exhumer. Il faut donc creuser. Pour que parvienne à la lumière ce qui jusqu’alors persistait dans l’ombre, telle une faille infranchissable. Car écrire est bien ce travail de taupe qui se fait à l’aveugle, dans l’incertitude de ce qui va surgir. »
Angèle Paoli, « Le ça de Christiane Veschambre », Terres de femmes, avril 2020À propos de dit la femme dit l’enfant, Geneviève Peigné a écrit à l’auteure :
« Je viens de lire dit la femme dit l’enfant.
Projet essentiel, nécessaire, de cerner ce rapport de l’enfant et du présent de soi. Moteur constant d’écriture que cette relation, me semble t‑il. Combien de fois n’ai je pas senti que c’est lorsque ce qu’on écrit reçoit l’aval de l’enfant (ce qui apparaît quelquefois dans les rêves) qu’on est au juste lieu ? J’aime le ton de gravité, la tenue, le pas à pas du texte. Qu’il tienne à la fois les rênes de l’intime et du monde social qui façonne, aiguillonne ou ligote l’intime. D’y retrouver la toute puissance – redoutable, bienfaitrice – de l’enveloppement maternel. Livre exact. Merci. »Et Ariane Dreyfus :
« C’est un livre de pensée véritable, pas de narration superficielle ni de pensées convenues, comme beaucoup de livres qui font revivre l’enfance de leur auteur. Ce que d’ailleurs tu ne fais pas. Ce n’est pas l’enfance que tu fais revivre, mais l’enfant que tu veux regarder et qu’elle te regarde aussi, et par le biais de ce double point de vue, appréhender la courbe de la totalité de ta vie.
dit la femme dit l’enfant est un livre d’exploration, que nous faisons avec toi, un livre d’intelligence sensible. Je retrouve ta capacité à utiliser des éléments pourtant bien réels, concrets, qui font les décors de nos vies, par exemple le seuil, le tapis, la poussière, le piano, comme des pendules capables de nous orienter vers l’invisible, vers les émotions les plus ténues et indicibles. Grâce à cela, qui ne relève pas du métaphorique ou du symbolique, tu mêles inextricablement l’analyse et le sensible, avec une clarté d’une délicatesse telle que tu peux te permettre d’aborder toute la réalité de la vie, même les plus difficiles à dire, comme ces moments dans les toilettes à la turque. Tu fais œuvre à la fois de connaissance et d’émotion, et la compréhension ne s’arrête pas à ta personne, tu fais aussi œuvre politique à certains moments, très souvent même.
Tenue constante de ton livre, dans lequel des présences exigeantes comme celle de Deleuze ou de Dickinson, sans compter les films, se confondent avec ta propre matière tout en conservant exactement leur finesse propre. Je ressens ton livre comme un immense travail, qui a dû exiger de toi une immense écoute et concentration. »« Une rencontre. Ou comme une rencontre. Entre deux personnages, qui sont d’abord surtout des voix, car leur présence l’un pour l’autre est mal assurée : présence de fantômes qui n’ont pas besoin de se rendre visibles, on les sait là, dans la pièce où l’on se tient. Voix qui monologuent chacune pour elle-même plutôt qu’elles échangent. dit la femme dit l’enfant, le titre choisi par Christiane Veschambre dit beaucoup sur ce qui attend le lecteur dans ce livre […].
Entre la femme, dont on sait très vite qu’elle écrit, et l’enfant, une distance, qui les fait apparemment étrangères l’une à l’autre : distance physique, la petite se tenant selon la dramaturgie suggérée, à quelques pas du seuil, mais dedans et loin de son interlocutrice ; distance historique, chacune évoluant en un temps différent, chacune paraissant comme rêvée par l’autre. Distance sociale avant tout : Ta maison est pour moi un terrier. Un terrier natal, dit la femme à l’enfant, laquelle les tapis empêchent d’avancer : Ils ne font pas richesse, non, ils font autre monde. Il y a chez Christiane Veschambre tout un art de la suggestion, la relation entre les deux personnages se construit en douceur, et on ne peut qu’être sensible à la capacité de l’auteure de réinventer pour chaque livre une forme nouvelle, dépaysante tout d’abord, pour en revenir néanmoins à des données autobiographiques connues, exposées déjà dans les ouvrages précédents : une manière de récompense aux lecteurs les plus fidèles : Lorsque je téléphone à Noémie, elle me dit que j’ai la voix de Joséphine, ma mère, confesse dès le premier chapitre la dame, comme significativement la désigne l’enfant, et renvoyant à un titre comme Robert & Joséphine, au catalogue des éditions Cheyne depuis 2008. […]
Et c’est bien la tâche que s’est donnée Christiane Veschambre : d’écrire, afin d’être agréée dans les autres mondes, de s’inventer une langue d’écrivain pour protéger mon père et ma mère. »
Claude Vercey, Décharge, 17 juin 2020Emmanuel Falguières, réalisateur du très beau film documentaire Nulle part avant (2018), qui retrace des « morceaux de vie » de trois femmes, dont Christiane Veschambre, a écrit à l’auteure :
« C’est un livre magnifique. Dans les émotions qui circulent entres les pages, dans le dialogue, paragraphe à paragraphe, il y a une surprise inouïe à lire ces lignes qui te ressemblent tout à fait, qui sont “tout contre” l’écrivaine que tu es et simultanément si neuves, si différentes, si profondément renouvelées par l’abandon de l’étrangère, par l’apparition d’une petite fille que tu reconnais comme je et comme autre. Le fait que ce pas-ci fasse suite à Basse langue, comme Basse langue faisait suite à La griffe et les rubans, comme La griffe et les rubans faisait suite au Lais de la traverse – pour ne tirer que ce chemin-là parmi les pages écrites par toi – est sidérant, comme est sidérant le “vivant de la vie”. Que trouve-t-on une fois traversé la terre noire du soubassement ? Une fois que l’on a fait signe à ce qui a appelé ? On retrouve le temps troué. Peut-être était-ce lui, le temps des hommes et des femmes, qui, déguisé comme dans les mythes grecs, faisait signe ? Un “battement silencieux”.
J’ai trouvé dans ce texte une force, qui me semble être la tension de ce regard entre l’enfant et la femme dans la pièce aux tapis. Tout le livre s’arc-boute dans cette impossible et inévitable rencontre. Comme La griffe et les rubans s’arc-boutait entre ses deux textes. Et là encore, tu tends des fils, qui ne seront jamais un pont, même s’ils veulent faire liens, entre ces deux piliers plantés dans le sol.
La force de l’enfant me fait penser que tu y as retrouvé l’inébranlable qui constituait le fondement du texte de “l’enfant-ma-mère”. Ainsi comme la photo de ta mère que tu reconnais sans reconnaître, cet enfant que tu es te regarde, et porte sans le savoir la force de la non-née. »« Deux voix s’interrogent, se répondent, s’accordent : la femme et l’enfant. S’agit-il de la même personne, à deux temps de la vie ? Je m’interroge encore. S’agit-il d’un récit autobiographique ? Ce n’est pas certain, même si les blessures semblent si réelles qu’on imagine l’auteure les ayant vécues ou perçues. On entend bien la présence de la mère de “la femme”, et même de sa grand-mère, celle qui vivait dans La Maison de terre, livre paru en 2006 aux éditions Le Préau des collines. […]
On est loin du roman avec ce texte, on est dans une exactitude du mot pour le mot, un puzzle construit avec tous les essais nécessaires au tableau final.
À vous de voir si dit la femme dit l’enfant fait parler en vous, ce ça qu’il fait parler en vous. »
Françoise Lalot, La Semaine de la poésie de Clermont, juillet 2020« Dépassant toujours la mesure, la séparation qui advient de la naissance n’en finit pas d’être un gouffre, un gouffre irréparable. Cependant le langage et la tendresse rattachent comme ils peuvent, progressivement, la mère à l’enfant, et c’est tout un monde qu’il faut apprivoiser, avec l’imagination que peut donner quelqu’un d’attentif et surpris. De cet étonnement d’un être face à un autre, sensément le plus familier, le plus instinctuel, Christiane Veschambre a fait un beau livre, une recomposition de ces deux intériorités qui se trouvent, par la génération, en vis-à-vis, la mère et la fille (l’enfant parle au féminin). Parfois, par un effet de cascade, la mère évoque sa propre mère, l’informe de la vieillesse, la répugnance face à la condition infernale ; celle de l’ultime décadence corporelle, l’abandon de soi, comme il y en a eu jadis, précédent l’enfance, une sorte d’informe, mais qui, quand l’autre se désagrège, avait à se regrouper et prendre corps. »
Jean-Claude Leroy, « Dit la femme dit l’enfant, l’enfance croisée par Christiane Veschambre », Mediapart, 25 août 2020« La structure du livre est simple, et non traditionnelle. Un faux dialogue entre deux personnages. La femme et la fillette parlent chacune leur tour. Ce sont moins des paroles dites que des paroles rapportées, comme des monologues intérieurs qui se suivent, avec parfois l’effet question-réponse comme si le dialogue de sourdes laissait passer des propos audibles par moments. Dans cet affrontement de regards à distance, chacune raconte son histoire, ses gestes, sa vie. Il y a correspondance, semble-t-il, malgré la différence d’âges. On est dans un théâtre intérieur où les didascalies sont intégrées au texte. Un troisième personnage sous-tend ce face à face, représenté par la grand-mère ici et un homme là, qui symbolise l’incommunicable. Que les deux actrices essaient de briser entre elles. La femme, la plus proche de l’auteure aujourd’hui : on n’écrit pas pour caresser, mais pour concasser. Concasser ce qui veut faire bloc, ce qui veut faire ordre… L’enfant représente certainement l’auteure auparavant, lorsqu’elle restait à la porte de “l’autre monde”, celui des adultes en particulier. Les deux voix vont finir par se mêler, se mélanger, pour n’en former plus qu’une seule. Et le dialogue abscons de se fondre en un soliloque plus cohérent. Le futur de l’une, le passé de l’autre de se réunir dans un présent où l’origine du vivre et de l’écrire tente de prendre sens et d’expliquer les questions qui tenaillent l’écriture de Christiane Veschambre. Le lecteur est bientôt fasciné par cet échange âpre et tendu entre deux images d’une même personne et ne quitte plus ces approches parallèles de l’être, vecteur du temps, à la recherche de soi et de son énigme en résolution… la phrase se glisse entre ma colère et ma honte, tombe en moi, s’enfonce dans mon sol sous-marin, et remontera comme une bulle au réveil d’une journée perchée sur les échasses du temps depuis écoulé… »
Jacmo, Décharge, n° 187, septembre 2020