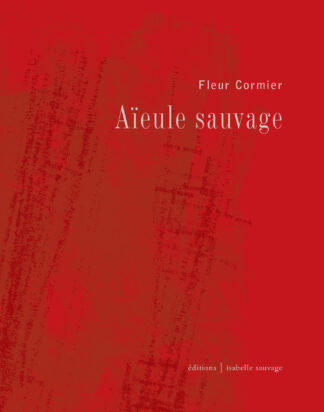Description
« L’enfance ça tient mal la route le cheval à bascule M. Culbuto tout chute ». Dans ce « récit » d’une enfance trompée, c’est avec « un jeu des sept familles » que Nathalie B. Plon propose d’abord de jouer, avec les cartes de la mère, la fille (la narratrice) et le(s) père(s). La mère ? « Maman a joué à la poupée vrillée désarticulée déshabillée doigts mâchouillés tête dévissée jambe retournée […] Maman n’a jamais su jouer pour du faux ». Le père ? Il semble bien qu’il y ait plusieurs cartes… Le premier père, « rien d’un pôle paternel pas caresse pas baiser pas chanson douce ». Un père « qui tresse à la boussole cachets matin midi soir ». Ce père aussi, absent et silencieux, « dans sa boîte » — mort ? ailleurs ? (« Ce père au balcon tout basculé par-dessus bord un chausson est resté »). Et mon père, une image, un Polaroïd ? Celui-là est tout à la fois intime et rêvé : « Mon père dans le vent… », « il est beau mon père il est beau mon père… ». Et jalousement gardé vivant par la (petite) fille, bien malgré la mère. Le père, celui qu’on demande, celui qu’on pourra réclamer « quand je serai grande », reste une carte impensable. Et quoi qu’il en soit, n’étant pas vraiment là, il laisse un face-à-face terrifiant entre fille et mère, où domine plutôt l’impression d’un jeu des sept erreurs.
Alors il y a peu d’issues… « convoquer les chrysanthèmes (il y a prescription) autour de la table et avaler avec la foi les miettes un passé mité […] inventer sa langue même morte pour avancer son pion » ou « mettre la camisole de force avancer dans le noir — un chantier interdit au public — ». Et la colère, solitaire, et le « devoir » filial : « je à aboyer sous la lune pleine à craquer », « je mourir une autre fois je crier gare malgré je t’aime au museau — aimer maman — pleurer maman — ».
Ce « récit » familial écrit dans une langue bousculée, crue et imagée tout à la fois, secoue les expressions toutes faites pour les réinventer ou leur donner tout leur sens, retrace paradoxalement quelque chose de la magie de l’enfance quand justement celle-ci ne l’est pas, enchantée. Les mots volent drus, les verbes souvent à l’infinitif figent les personnages en objets d’un destin, ballottés par une histoire trop tourmentée pour eux, où il ne reste plus qu’à « Faire avec ça ».
Notes de lecture
« De Nathalie B. Plon, née en 1969, Faire le mort et aboyer, une première plaquette (au diable les premiers romans) paraît à la cinquantaine aboutie ; d’avoir tant amassé avant jaillir coupe le souffle. À flux tendu, pis serré dans la machine à traire, taire soi où faire le mort abonde dans le désir de maman. Par cagnard, sous la constellation du Chien, l’aile du cynisme la frôle dans cet aboi.
“Quand je serai grande j’aboierai / Quand je serai grande j’aboierai //// Quand je serai grande j’aboierai //// On m’a dit de la pluie – Elle se suicide quand elle tombe.” Sur les brisées d’Agnès Rouzier, de même souffle implacable. Se promenant pieds nus où le cynisme mord. Non celui des mots crus mais la crudité passée en langue. Quand “la pluie se tord comme du chien mouillé”. La langue d’abois seule à pouvoir jaillir parmi les débris de celle de bois, “bouches cousues plein les poches à crever les yeux”. Insoutenable, cinglant toute connaissance de soi par le travers.
À lire à très petites gorgées sur le long cours, afin qu’au plus ténu cela s’immisce et s’imprègne. »
Christophe Stolowicki, Libr-critique, 18 juillet 2021