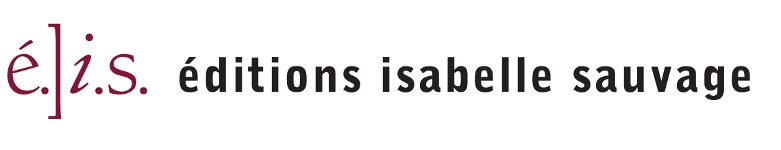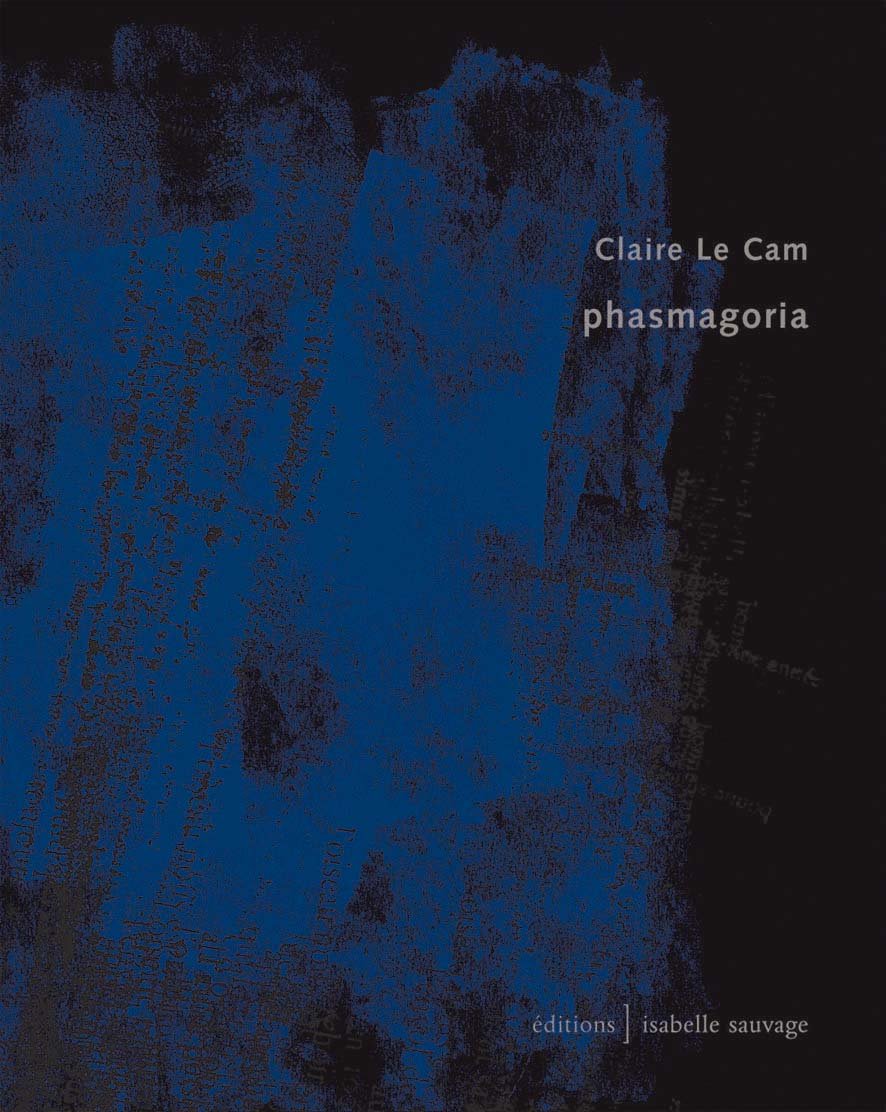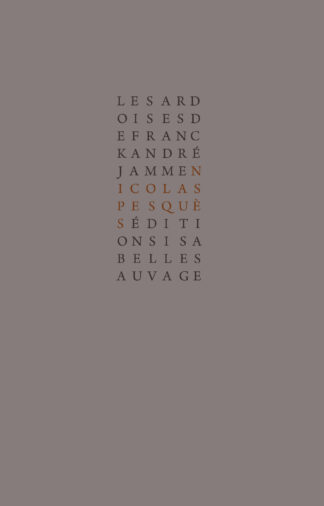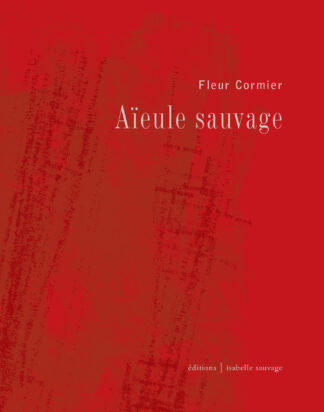Description
Phasmagoria est né d’« une idée animalo-humano-tragico-rigolo », selon les propres termes de Claire Le Cam. Le ton est donné ; le titre l’annonce. Comme si Claire Le Cam avait fait sienne l’étymologie du mot « fantasmagorie » donnée par P. Guiraud : « hybride populaire » de « fantasme » et de « gourer » (tromper) en l’appliquant au phasme (du grec phasma, « fantôme », quand fantasmagorie provient de phantasma, « apparition »), cet insecte imitant la forme des tiges sur lesquelles il séjourne, archétype du mimétisme.
Le phasme est donc le point de départ d’une rhétorique absurde et sensible que Claire Le Cam mène tambour battant pour nous rappeler, de façon encore plus construite et plus décalée que dans Raccommoder me tourmente, son précédent livre, l’omniprésence du corps, le lieu par où tout passe, tout s’exprime : « l’homme-phasme est accouché ».
L’ouvrage est composé en trois parties : 1) Le mime est l’homme-phasme, il plagie le modèle, il trompe le dupe, mais, à force, il peut aussi se manipuler lui-même ; cette partie présente l’homme-phasme par des phrases d’une ligne, toutes numérotées. 2) Le dupe, ennemi ou victime du mime ; où sont présentés ceux que l’homme-phasme abuse : sa femme, ses amis, ses collègues, ses voisins, ses animaux… mais encore un dupe se dupant lui-même ; cette partie renvoie via les lignes de la première partie aux thèmes ou aux gens concernés. 3) Le modèle, émetteur des stimulus, où il est question des lieux, des gens, des livres, ou des personnages… que l’homme-phasme a mimés ; des descriptions en quelques phrases décalées.
L’écriture de Claire Le Cam est comme un jeu où « toute ressemblance avec mimes, dupes et modèles qui pourraient se sentir concernés est purement fortuite ». « Vous, vous qui mâchez ce que vous voulez bien accepter de l’autre, ceux, celle, ou celui qui pourraient vous laisser ou pas quelque chose à mâcher. / On ne sait pas qui parmi vous est dupe. » Voilà le lecteur prévenu.
Notes de lecture
« Ici l’aspect formel invite le lecteur à une véritable activité de participation à la lecture. Il devient partie prenante du texte. […] Exigeant certes mais sans être austère car la distance par l’allusion, le sourire, la connivence, bref, ce qui fait l’humour dans la langue, est ici très présent. »
Christian Vogels